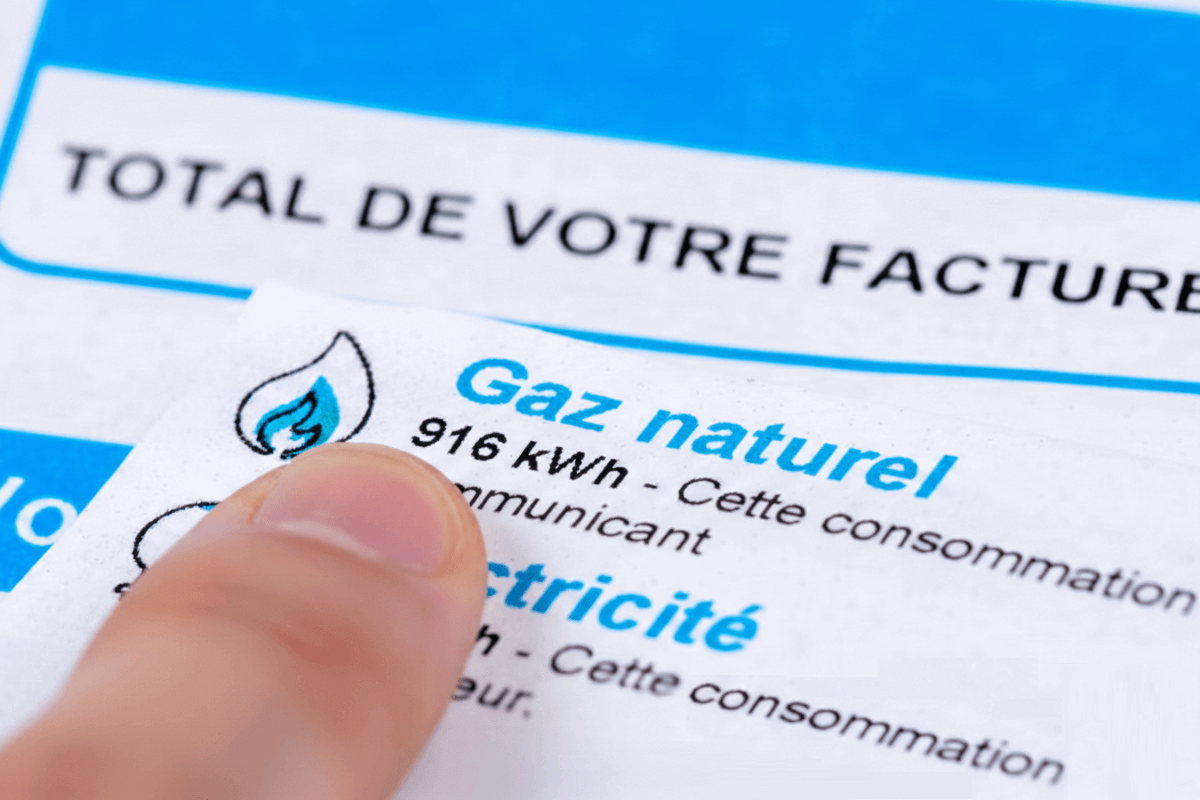Grève chez EDF : la production d'électricité a chuté, l'équivalent de 4 réacteurs nucléaires à l'arrêt
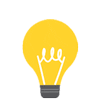
Envie de changer de fournisseur d'électricité ?
Comparez et changez d'offre gratuitement avec les experts JeChange :

L'offre du moment à -15,5% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
Le mouvement de grève du jeudi 18 septembre met le réseau électrique français sous tension. Particulièrement suivie dans le secteur de l'énergie, la mobilisation a contraint EDF à annoncer une chute de production équivalente à la mise à l'arrêt de quatre réacteurs nucléaires. Un mouvement social d'ampleur, motivé par des revendications salariales et le rejet du projet de budget du gouvernement. Faut-il craindre des coupures ?
4 000 MW en moins sur le réseau : l'impact concret de la grève
L'impact est direct et significatif. À la mi-journée, EDF a officiellement déclaré une perte de puissance disponible de 4 000 mégawatts (MW) sur son parc de production. Pour se faire une idée, cela correspond à la production de quatre réacteurs nucléaires de taille moyenne, sur les 57 que compte le pays.
Cette baisse de production, orchestrée par les salariés grévistes, a touché un éventail de centrales stratégiques pour le réseau :
- Centrales nucléaires : Saint-Alban (Isère), Flamanville (Manche) et Saint-Laurent (Loir-et-Cher).
- Centrales thermiques au gaz : Blénod (Moselle) et Martigues (Bouches-du-Rhône).
- Parc hydraulique : Une perte de puissance de 110 MW a également été signalée.
EDF a prévenu que cette "baisse de production est susceptible de se prolonger jusqu'à la fin du mouvement social annoncé", faisant peser une incertitude sur la disponibilité du parc électrique dans les jours à venir.
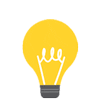
Envie de changer de fournisseur d'électricité ?
Comparez et changez d'offre gratuitement avec les experts JeChange :

L'offre du moment à -15,5% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
Une mobilisation importante chez les électriciens et gaziers
L'impact sur la production s'explique par un mouvement social très suivi. Chez EDF, le plus gros employeur du secteur, la direction a relevé un taux de 17% de grévistes sur les effectifs totaux de l'entreprise.
La mobilisation est encore plus importante chez Enedis, le gestionnaire du réseau de distribution. La CFE-Énergie, deuxième syndicat de la branche, a fait état d'un taux de grévistes de plus de 27% sur les effectifs totaux, un chiffre confirmé par la direction et qualifié de "taux important" par une source syndicale.
Cette forte participation montre que le mouvement est bien plus large que la seule grève du 10 septembre, qui était alors portée uniquement par la CGT.
Salaires, budget : les raisons d'une double colère
Cette journée de grève est le point de convergence de deux mouvements distincts, ce qui explique son ampleur.
- Le contexte national : L'appel a été lancé par une intersyndicale unie (regroupant l'ensemble des syndicats) pour protester contre le projet de budget du gouvernement.
- Le contexte sectoriel : Dans les industries électriques et gazières, la CGT est déjà en grève depuis le 2 septembre. Ses revendications sont ciblées : une hausse des salaires pour contrer l'inflation et un abaissement de la fiscalité sur l'énergie, qui pèse lourdement sur les factures des Français. La CGT a d'ailleurs revendiqué une "grosse mobilisation" sur ses bastions, notamment les terminaux méthaniers et les sites de stockage de gaz.
Faut-il craindre des coupures d'électricité ?
Pour l'instant, le risque est maîtrisé. Une baisse de charge, même de l'ampleur de quatre réacteurs nucléaires, n'entraîne pas de coupure immédiate pour les consommateurs. Le rôle de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, est précisément d'assurer l'équilibre entre la production et la consommation en temps réel.
Pour compenser cette perte, RTE peut activer plusieurs leviers, comme l'augmentation de la production des centrales non grévistes, l'utilisation des barrages hydrauliques ou l'importation d'électricité depuis les pays voisins.
Toutefois, la situation pourrait se tendre si le mouvement social venait à durer ou à s'intensifier, notamment en cas de vague de froid.
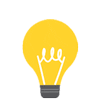
Envie de changer de fournisseur d'électricité ?
Comparez et changez d'offre gratuitement avec les experts JeChange :

L'offre du moment à -15,5% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère